Les images sont-elles toutes de la même famille ? De l’unité de l’imagination
 Je contemple “la” gravure de Dürer ; puis, l’abandonnant, j’imagine un chevalier affrontant la mort ; enfin je m’assoupis et voici que ce que je contemplais ou imaginais, je le rêve. Le sujet visé mis à part, quoi de commun entre ces différents actes de ma conscience ? L’un suppose le sommeil et les deux autres un état de veille. Dans un cas nous fait face une feuille de papier recouverte de traits noirs et inscrite dans l’espace de la perception, dans les deux autres la conscience forme, indépendamment semble-t-il de tout support, une image de son choix. Ne doit-on pas seulement dans ces deux derniers cas parler au sens propre de re-présentation (Vergegenwärtigung) ou, selon la traduction adoptée par Sartre que nous conserverons dans cette étude, de présentification ? Est-il possible dans ces conditions d’invoquer à chaque fois une seule et même fonction de la conscience ? Ne faut-il pas au contraire soigneusement distinguer entre une conscience d’image à partir d’un support matériel perceptible dans l’espace objectif et l’image mentale ? La spatialité de l’une est-elle la spatialité de l’autre ?
Je contemple “la” gravure de Dürer ; puis, l’abandonnant, j’imagine un chevalier affrontant la mort ; enfin je m’assoupis et voici que ce que je contemplais ou imaginais, je le rêve. Le sujet visé mis à part, quoi de commun entre ces différents actes de ma conscience ? L’un suppose le sommeil et les deux autres un état de veille. Dans un cas nous fait face une feuille de papier recouverte de traits noirs et inscrite dans l’espace de la perception, dans les deux autres la conscience forme, indépendamment semble-t-il de tout support, une image de son choix. Ne doit-on pas seulement dans ces deux derniers cas parler au sens propre de re-présentation (Vergegenwärtigung) ou, selon la traduction adoptée par Sartre que nous conserverons dans cette étude, de présentification ? Est-il possible dans ces conditions d’invoquer à chaque fois une seule et même fonction de la conscience ? Ne faut-il pas au contraire soigneusement distinguer entre une conscience d’image à partir d’un support matériel perceptible dans l’espace objectif et l’image mentale ? La spatialité de l’une est-elle la spatialité de l’autre ?
Et pourtant si on dit “voir” ou “regarder” un portrait, des photographies, une gravure, nul ne dira que le chevalier de Dürer est perçu. Ni perçu, ni signifié, c’est-à-dire visé à vide, doit-on dire alors que dans le rêve, dans l’imagination comme dans la “perception” de la gravure, le chevalier est donné en image ? Et dans un même mouvement ne doit-on pas élargir le champ de l’imagination et y introduire toutes ces “images” que sont le reflet de mon visage dans un miroir ou à la surface de l’eau, l’ombre d’un corps ou d’une maison engendrée par la lumière du soleil, le visage que je découvre dans les arabesques du tapis ou dans les volutes d’un nuage, etc. ?

 Du point de vue de l’histoire de la philosophie, il est frappant de voir deux philosophes aussi différents que Fichte et Bergson accorder à l’image un rôle essentiel pour traiter du rapport de l’esprit au monde. Ce que Bergson fait dans Matière et mémoire sur le plan d’une psychologie philosophique, en vue d’expliciter la nature de la perception, Fichte le fait dans le contexte différent de la systématisation de l’idéalisme transcendantal, en développant une W.L. , une logologia qui deviendra une doctrine de l’image. On ne poursuivra pas ici le parallèle entre les deux auteurs pour ce qui est du traitement de l’image, on s’intéressera seulement à la fonction du Bild, du Bilden dans la pensée de Fichte. Généralement on voit dans la W.L. une systématisation de l’idéalisme critique et de la théorie kantienne du schématisme, ce qui expliquerait le rôle donné à l’imagination (Einbildungskraft) dans l’analyse fichtéenne du mécanisme de production des représentations nécessaires du Moi fini. Cependant, jusqu’en 1800, jamais le premier Fichte n’a déduit du rôle éminent de l’Einbildungskraft la conséquence selon laquelle nos représentations ne seraient que des images de l’être : si le Moi est producteur d’images, en aucun cas Fichte n’accepte ici un dualisme réel entre le phénomène et la chose en soi, que la théorie de l’imagination transcendantale a justement pour but de supprimer. Les images comme produits renvoient à l’activité du Moi et non à un être hors du Moi, a fortiori supérieur au Moi. L’image comme telle ne devient l’objet d’une thématisation explicite par Fichte que lorsque l’Einbildungskraft est pensée à partir de la nature de Bild, ce qui semble paradoxal puisque le produit semble éclairer l’instance productive, défiant tout ce que l’idéalisme critique nous avait appris jusque là. Cette inversion n’a rien de surprenant si on rappelle les médiations spécifiques qui renvoient au destin de la W.L. lors de sa réception et si on tient compte des objections émises à son propos par les adversaires et les contradicteurs de Fichte. Après la Lettre de Jacobi et la Querelle de l’Athéisme, Fichte modifie la présentation de la W.L. et opère des modifications doctrinales qui lui apparaissent indispensables pour sauver l’idéalisme face au nouveau dogmatisme qui s’annonce.
Du point de vue de l’histoire de la philosophie, il est frappant de voir deux philosophes aussi différents que Fichte et Bergson accorder à l’image un rôle essentiel pour traiter du rapport de l’esprit au monde. Ce que Bergson fait dans Matière et mémoire sur le plan d’une psychologie philosophique, en vue d’expliciter la nature de la perception, Fichte le fait dans le contexte différent de la systématisation de l’idéalisme transcendantal, en développant une W.L. , une logologia qui deviendra une doctrine de l’image. On ne poursuivra pas ici le parallèle entre les deux auteurs pour ce qui est du traitement de l’image, on s’intéressera seulement à la fonction du Bild, du Bilden dans la pensée de Fichte. Généralement on voit dans la W.L. une systématisation de l’idéalisme critique et de la théorie kantienne du schématisme, ce qui expliquerait le rôle donné à l’imagination (Einbildungskraft) dans l’analyse fichtéenne du mécanisme de production des représentations nécessaires du Moi fini. Cependant, jusqu’en 1800, jamais le premier Fichte n’a déduit du rôle éminent de l’Einbildungskraft la conséquence selon laquelle nos représentations ne seraient que des images de l’être : si le Moi est producteur d’images, en aucun cas Fichte n’accepte ici un dualisme réel entre le phénomène et la chose en soi, que la théorie de l’imagination transcendantale a justement pour but de supprimer. Les images comme produits renvoient à l’activité du Moi et non à un être hors du Moi, a fortiori supérieur au Moi. L’image comme telle ne devient l’objet d’une thématisation explicite par Fichte que lorsque l’Einbildungskraft est pensée à partir de la nature de Bild, ce qui semble paradoxal puisque le produit semble éclairer l’instance productive, défiant tout ce que l’idéalisme critique nous avait appris jusque là. Cette inversion n’a rien de surprenant si on rappelle les médiations spécifiques qui renvoient au destin de la W.L. lors de sa réception et si on tient compte des objections émises à son propos par les adversaires et les contradicteurs de Fichte. Après la Lettre de Jacobi et la Querelle de l’Athéisme, Fichte modifie la présentation de la W.L. et opère des modifications doctrinales qui lui apparaissent indispensables pour sauver l’idéalisme face au nouveau dogmatisme qui s’annonce.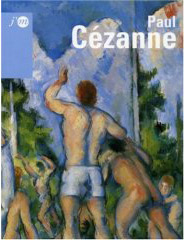 Décrivant la perception, parce que penser, c’est, selon l’exigence husserlienne, revenir par une question en retour sur l’évidence du monde, Merleau-Ponty la découvre, dès la Phénoménologie de la Perception, comme jeu du sujet et du monde où tous deux surgissent, co-naissent dans un rapport qu’il faut penser comme recouvrement de l’un par l’autre.
Décrivant la perception, parce que penser, c’est, selon l’exigence husserlienne, revenir par une question en retour sur l’évidence du monde, Merleau-Ponty la découvre, dès la Phénoménologie de la Perception, comme jeu du sujet et du monde où tous deux surgissent, co-naissent dans un rapport qu’il faut penser comme recouvrement de l’un par l’autre.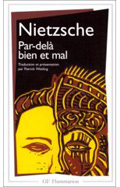 Au début de la Généalogie de la morale, Nietzsche s’interroge et exprime ses soupçons quant à l’origine de la morale. Nietzsche mène une réflexion sur la provenance de nos préjugés moraux, sur l’origine du mal, sur la préhistoire du Bien et du Mal. Nietzsche examine également la valeur de la pitié et de la morale de la pitié, des « valeurs » morales.
Au début de la Généalogie de la morale, Nietzsche s’interroge et exprime ses soupçons quant à l’origine de la morale. Nietzsche mène une réflexion sur la provenance de nos préjugés moraux, sur l’origine du mal, sur la préhistoire du Bien et du Mal. Nietzsche examine également la valeur de la pitié et de la morale de la pitié, des « valeurs » morales.