Définir, décrire, classer chez Aristote : des opérations propédeutiques à la connaissance scientifique des choses
Définir, décrire, classer – cela suffit-il pour connaître les choses ? Le plus notable de prime abord dans cette liste de trois opérations de pensée, c’est moins leur profusion, qui dissémine certes la connaissance des choses en de multiples actes, que la restriction que cette liste impose. Non seulement la trinité ainsi constituée représente une coupe drastique dans la diversité des actes par lesquels on a pu décrire l’accomplissement d’une connaissance des choses – percevoir, intuitionner, sentir, juger, déduire, induire, expliquer, rendre raison, démontrer, prouver, manifester, dévoiler, diviser, rassembler, etc. – , mais, plus encore, on peine à saisir la raison qui anime un tel partage, le lien intime qui unit ces trois opérations et justifie qu’on les isole de toutes les autres – au risque que cet isolement et que ce regroupement ne manifestent que leur arbitraire.
Ou c’est peut-être, plus qu’un lien intrinsèque, une raison strictement négative qui pourrait donner un fondement à ce regroupement – comme si l’on se concentrait sur les opérations auquel on se donne encore droit quand toutes les autres sont apparues trop ambitieuses. Le plus frappant dans cette triade, c’est en effet l’omission du type d’opération par rapport auquel ces trois-ci n’ont été, pour les fondateurs de la philosophie, que des opérations adjuvantes ou préparatoires. Pour Platon en effet comme pour Aristote, connaître les choses, c’est les expliquer, en rendre raison en les rapportant à leur cause, pouvoir dire « pourquoi » elles sont comme elles sont. Et c’est par rapport à cette opération que définir, décrire ou classer peut s’avérer utile ou nécessaire, mais de manière seulement subordonnée.

 Il convient de lire Nietzsche avec l’attention d’un philologue pour tirer profit de ce qu’il a écrit. Il ne faut pas plaquer sur cette lecture de notions préétablies. Chez Nietzsche, il n’y a pas d’homogénéité systématique entre une doctrine générale nietzschéenne et le contenu de tel ou tel texte.
Il convient de lire Nietzsche avec l’attention d’un philologue pour tirer profit de ce qu’il a écrit. Il ne faut pas plaquer sur cette lecture de notions préétablies. Chez Nietzsche, il n’y a pas d’homogénéité systématique entre une doctrine générale nietzschéenne et le contenu de tel ou tel texte.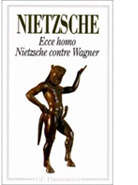 Ecce homo est le dernier ouvrage que Nietzsche a composé dans l’année 1888. Ce livre ne sera publié qu’en 1908. Nietzsche a terminé sa carrière intellectuelle le 6 janvier 1889, à Turin.
Ecce homo est le dernier ouvrage que Nietzsche a composé dans l’année 1888. Ce livre ne sera publié qu’en 1908. Nietzsche a terminé sa carrière intellectuelle le 6 janvier 1889, à Turin. Nietzsche se présente comme un penseur qui veut rompre avec les idéaux anciens, philosophiques et religieux. Cependant, ses références sont essentiellement issues de la Bible et de Schopenhauer. Ses attaques contre la religion (christianisme) sont à la fois pertinentes et injustes. Il les conduit avec la véhémence des prophètes combattant les idoles, les faux dieux. Il met en cause le moralisme, comme Jésus l’a fait….
Nietzsche se présente comme un penseur qui veut rompre avec les idéaux anciens, philosophiques et religieux. Cependant, ses références sont essentiellement issues de la Bible et de Schopenhauer. Ses attaques contre la religion (christianisme) sont à la fois pertinentes et injustes. Il les conduit avec la véhémence des prophètes combattant les idoles, les faux dieux. Il met en cause le moralisme, comme Jésus l’a fait….