Le doute de Cézanne. Réflexions sur le paradoxe de l’œuvre de culture
Cézanne a souvent exprimé les difficultés, les tourments accompa-gnant son travail de peintre, comme le rappellent les premières lignes du texte.
En outre son œuvre a commencé par surprendre, choquer, susciter des critiques très négatives. Cette réception négative, ces difficultés ont conduit Cézanne, ses amis, ses contemporains à s’interroger sur le sens de son effort et la valeur du résultat.
Deux manières se sont présentées de rendre compte de l’originalité de cette œuvre et de ce qui a pu, à une certaine époque, passer pour son « échec ». L’originalité, l’échec seraient dus :
– soit aux aléas de la vie, une maladie, une constitution schizoïde – hypothèse qui est, selon Merleau-Ponty, vaine plutôt que fausse car si elle fait connaître quelque chose de l’œuvre (ce que Merleau-Ponty n’exclut pas), elle n’en fait pas connaître « le sens positif »
– soit au « paradoxe » du projet pictural : « rechercher la réalité sans quitter la sensation » ou, selon E. Bernard (qui fait de ce paradoxe une contradiction destructrice), viser la réalité en s’interdisant les moyens de l’atteindre.
Merleau-Ponty va travailler, critiquer ces deux manières de comprendre la peinture de Cézanne, dans l’ordre inverse où il les a présentées : il s’explique d’abord avec l’affirmation selon laquelle il y aurait une contradic-tion dans le projet pictural puis il traite du rapport entre l’œuvre et la vie. Cette seconde partie commence par : « Ainsi les “hérédités”, les “influences”, – les accidents de Cézanne – sont le texte que la nature et l’histoire lui ont donné pour sa part à déchiffrer… ».
Je ne commenterai pas cette seconde partie où il est moins question de Cézanne que de Léonard de Vinci (et de lecture freudienne de l’œuvre d’art), je travaillerai surtout autour du « paradoxe » de l’œuvre de Cézanne, tout en revenant, à la fin, sur le rapport entre les difficultés de l’œuvre et les nœuds de la vie.

 Si on a choisi ici la série conceptuelle vie-multitude-événement pour parler de la pensée du politique aujourd’hui, c’est
Si on a choisi ici la série conceptuelle vie-multitude-événement pour parler de la pensée du politique aujourd’hui, c’est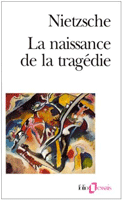 Tous les symptômes de la morale sont des formes d’une volonté. La morale nie toujours la vie. Ainsi la vie se détruit-elle elle-même. Donc l’avenir de la vie n’est pas du côté de la morale destructrice de la vie, mais du côté du dionysiaque.
Tous les symptômes de la morale sont des formes d’une volonté. La morale nie toujours la vie. Ainsi la vie se détruit-elle elle-même. Donc l’avenir de la vie n’est pas du côté de la morale destructrice de la vie, mais du côté du dionysiaque.